Grand Conseil et Gouvernance de l’École obligatoire
L’œuvre pionnière de Val-de-Travers
« Aucun sujet n’est plus important que celui de l’école. Pourtant, la droite ne s’en occupe pas et la gauche s’en occupe mal ! ». Ce propos d’Edouard Philippe, ancien premier ministre français, semble démenti par le Grand Conseil neuchâtelois. Il s’est en effet trouvé, le 5 novembre dernier, une majorité de députés – 76 –, tous bords confondus, pour soutenir une motion interpartis en faveur d’une révision du mode de gouvernance de l’école obligatoire. Motion heureusement amendée par le Conseil d’État en une demande de bilan et d’évaluation sur la nécessité de réviser le mode de gouvernance.
Opportunisme électoral, pour les uns, flatterie envers des syndicats d’enseignants pour d’autres, ou encore volonté de « dégraisser le mammouth », bref, une convergence d’intérêts disparates a permis ce consensus chez nos députés.
La question de la cantonalisation de l’École neuchâteloise bruisse depuis plusieurs années. Faute à un manque de suivi de l’État ! Pire, à un refus de finaliser ce transfert de compétences. D’où cette tension toujours entre le désir légitime d’autonomie des régions et le souci, tout aussi légitime, de l’État d’assurer la « haute gouvernance de l’école ».
Pour mémoire
Les raisons de cette réforme en 2011 ? Le concordat HarmoS, d’abord, envisageant une vision verticale de l’organisation scolaire sous l’égide d’une direction unique, la Convention scolaire romande, ensuite, dictant quelques mesures organisationnelles et pédagogiques. Deux textes acceptés par le peuple suisse en 2006. Considérant l’enseignement obligatoire comme un tout, sans transition entre préscolaire, primaire et secondaire 1, il est proposé de regrouper l’ensemble des écoles d’une région, de les placer sous une direction unique avec, à sa tête, un organe issu d’un exécutif. Ainsi sont nés les cercles scolaires.
Quant à la suppression des commissions scolaires survenue quelques années auparavant, rien à voir avec la régionalisation car issue d’un diktat d’exécutifs « chatouillés aux entournures » par l’existence d’un organe disposant d’autonomie financière propre.
Val-de-Travers, pionnier
À la lumière de ces décisions, fort d’une fusion des communes constituant, « naturellement », un cercle scolaire unique, l’exécutif de Val-de-Travers, selon la promesse forte d’« une école par village », a alors demandé au Conseil d’État cette autonomie organisationnelle, menant à la régionalisation. Les trois villes se sont alors précipitées dans cette dynamique, renforçant le processus en cours. Malgré certaines résistances internes, le Conseil d’État, avec la collaboration de l’Association des communes neuchâteloises, a décidé de mettre en œuvre cette réforme. Efficacité, rationalité et proximité, tels ont été les arguments en faveur de la régionalisation. Surtout, une plus grande autonomie des régions et une répartition plus efficiente des compétences entre l’État et les communes.
Aujourd’hui
Disons-le tout net : cette motion tombe à pic. Dès lors que la gouvernance de l’École se trouve « au milieu du gué », elle contraindra autorités cantonales, communales et syndicats à se mettre autour d’une table afin de dresser un bilan objectif des forces et des faiblesses actuelles. Une force ? L’autonomie des régions ! Pensez-vous que l’État, à l’ombre de ses murailles, aurait maintenu nombre de petites écoles du canton ? Comme pour la localisation des degrés et des cycles, et cette tendance de l’Etat à vouloir imposer un modèle unique ! Une faiblesse ? La perte de maîtrise de la réalité du terrain, par la suppression des inspecteurs-trices d’écoles d’alors. Ou encore, la stratification – le mille-feuilles trop épais – des directions en contradiction avec la volonté de verticaliser la scolarité.
En conclusion, il s’agit de confirmer la gouvernance régionale de l’École neuchâteloise. Ce sera sans doute la conclusion du rapport relatif à la motion. Après les élections…
Claude-Alain Kleiner

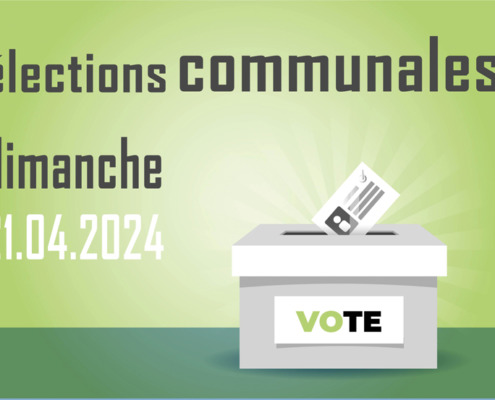
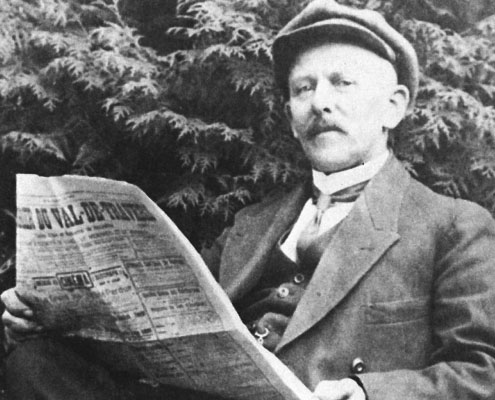
 Amélie Aeschbacher a gardé les bons réflexes lorsqu’il s’agit de poser.
Amélie Aeschbacher a gardé les bons réflexes lorsqu’il s’agit de poser.