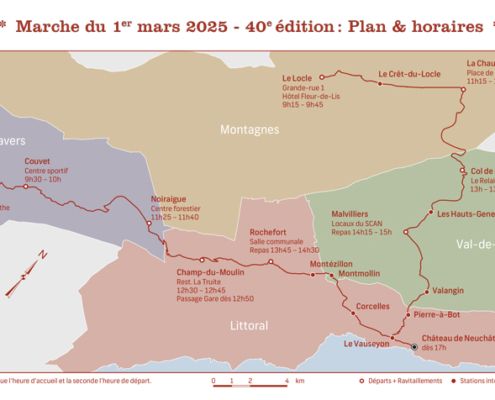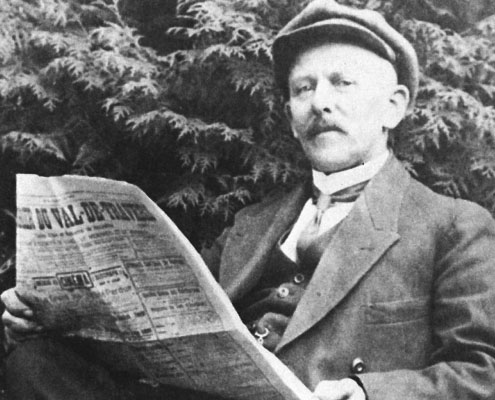Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco
Un Fleurisan d’adoption comme rédacteur
Le 16 décembre dernier, l’Unesco inscrivait les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art dans l’Arc jurassien au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Retour sur cet événement, d’une haute importance pour la région, avec l’un des rédacteurs de la candidature, Michel Bourreau, maître-horloger français installé à Fleurier.
En mars 2019, l’Office fédéral de la culture (OFC) et un groupe de pilotage franco-suisse composé d’artisans, de formateurs, d’entités muséales ainsi que de collectivités territoriales françaises (Grand Besançon Métropole et Pays horloger) soumettaient à l’Unesco leur candidature au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une candidature couronnée de succès puisque, depuis le 16 décembre dernier, « les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art » figurent désormais dans la liste de ce patrimoine qui consiste à recenser et préserver « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que des personnes, seules ou en tant que communauté, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ».
« Une prise de conscience »
« Cette entrée à l’Unesco a une importance énorme. C’est une prise de conscience de la spécificité, de la particularité, de ces savoir-faire », s’enthousiasme Michel Bourreau, un des rédacteurs de cette candidature. Le maître-horloger installé à Fleurier, collaborateur chez Parmigiani, est ravi de la reconnaissance internationale que représente cette inscription à l’Unesco, mais selon lui elle ne doit pas constituer une fin en soi. « En fait, c’est un peu un point de départ pour la préservation et la pérennité de ces connaissances techniques et artistiques », relève-t-il.
Bordelais d’origine, Michel Bourreau avoue que, d’une certaine manière, les populations des régions de l’Arc jurassien ne réalisaient pas véritablement la valeur de ce patrimoine. « Quand je suis arrivé dans la région, j’ai été impressionné par la densité d’artisans et de manufactures horlogères et la richesse des savoir-faire qu’ils véhiculent », s’exclame-t-il, encore saisi par la culture de la précision de la région. Pour le maître-horloger, la sauvegarde de ce patrimoine est perçue comme une nécessité. « En quelque sorte, il fallait remettre les pendules à l’heure », plaisante-t-il. Ainsi, lorsqu’il est approché, en 2018, pour intégrer le groupe de pilotage de la candidature, Michel Bourreau ne peut refuser. « Comme j’aime bien écrire, j’ai été tout de suite motivé à participer à la rédaction », explique-t-il, en ressortant l’épais dossier soumis à l’Unesco et ajoutant que cette candidature fut qualifiée d’exemplaire par l’Unesco.
Fruit d’une collaboration
La création du dossier de candidature a été le fruit d’une importante collaboration entre l’OFC, les collectivités territoriales frontalières et surtout tous les acteurs et détenteurs de ces savoir-faire. L’habitant de Fleurier ne manque pas d’évoquer la gestion remarquable du projet par l’OFC et l’excellente collaboration entre les autorités suisses et françaises. « Près de 80 entités de l’horlogerie et de mécanique d’art ont apporté leur consentement à cette candidature » détaille Michel Bourreau qui a lui aussi joint le sien au dossier. « Chose étonnante, mon soutien a été placé du côté suisse », s’amuse celui qui a emménagé au Vallon il y a six ans.
Jusqu’alors, Michel Bourreau avait un atelier d’horlogerie à Saint-émilion puis à Bordeaux. Le maître-horloger y développait notamment des procédés particuliers pour les horloges d’édifices. « Lors d’une rencontre autour des métiers d’art à Sainte-Croix, on m’a dit qu’en matière d’horlogerie c’était ici que cela se passait », sourit-il. Dont acte, à 58 ans, le natif du sud-ouest change d’air et s’installe à Fleurier.
Des savoir-faire dynamiques
Aujourd’hui, Michel Bourreau veut surtout militer pour la mise en valeur, la conservation et la transmission de ces savoir-faire. « Ces compétences, souvent artisanales, sont inestimables », insiste-t-il, en évoquant l’exemple de restauration d’anciens objets d’horlogerie ou de mécanique d’art, comme les boîtes à musique. Toutefois, il précise que ces savoir-faire ne sont aucunement figés, ils évoluent avec le temps et l’innovation, s’adaptent aux nouvelles exigences de production. « Il y a toujours de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, le dynamisme actuel est réel », énumère-t-il. L’histoire de l’horlogerie et sa constante innovation ne peut pas lui donner tort.
Également, le maître-horloger se réjouit des diverses manifestions culturelles et muséales qui pourront se mettre en place grâce à cette inscription à l’Unesco. L’actuelle exposition photographique commune entre le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le musée du Temps de Besançon en constitue la première. Et Michel Bourreau de souhaiter qu’elle ne sera pas la dernière.
Gabriel Risold